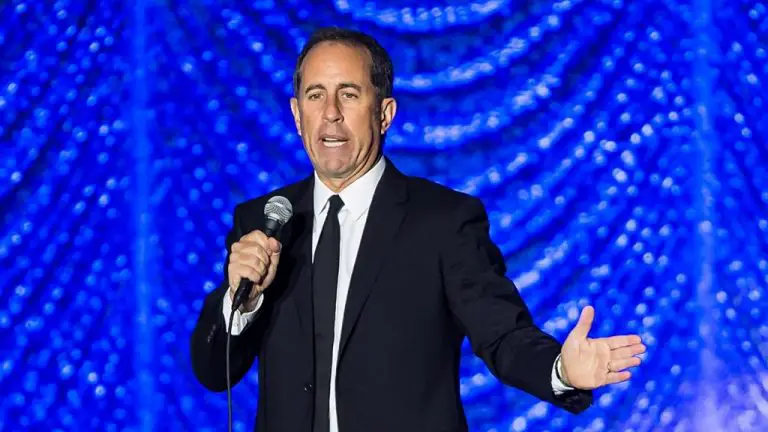Dans une maison modeste de la campagne anglaise, une jeune femme fouille à travers les effets personnels de sa mère. Parmi les boîtes à moitié emballées et les papiers encombrés, elle trouve une enveloppe de photographies. « Je n’ai pas vu beaucoup de photos de vous à Nagasaki, vous avez l’air si jeune », dit Niki (Camila Aiko), un écrivain japonais d’origine britannique à sa mère, Etsuko (Yoh Yoshida), avant de remettre l’une des images. Il y a une brustesse à leur interaction, une brièveté qui fait allusion aux secrets indicibles. Etsuko dit qu’elle n’avait pas eu l’intention de mettre les photos et de faire le lit.
Ces échanges furtifs aimables Une vue pâle des collinesL’adaptation trop prudente par Kei Ishikawa du premier roman du même nom de Kazuo Ishiguro. Le film, qui a été créé à Cannes dans la barre latérale de l’ONU avec une certaine égard, tresse ensemble deux histoires. La première se déroule dans l’Angleterre des années 1980, où Niki aide sa mère à se préparer à vendre leur maison. Alors que les deux femmes emballent une vie d’effets personnels, Niki interviewe sa mère sur la vie dans le Japon d’après-guerre. La jeune écrivaine, qui a récemment abandonné l’université et vit à Londres, travaille sur un mémoire sur sa famille et elle espère que ces conversations avec sa mère pourront l’aider à comprendre le suicide de sa sœur aînée Keiko. En travaillant avec DP Piotr Niemyjski, Ishikawa définit cette chronologie avec des tons frais – du bleu foncé, des légumes verts en sourdine et une pâleur grise qui hante chaque cadre.
Une vue pâle des collines
La ligne de fond
Réponse du risque à une faute.
Lieu: Festival de Cannes (un certain respect)
Casting: Suzu Hirose, Fumi Nikaido, Yoh Yoshida, Camilla Aiko, Kouhei Matsushita, Tomokazu Miura
Directeur-Screenwriter: Kei Ishikawa
2 heures 3 minutes
Le deuxième étage se déroule dans les souvenirs d’Etsuko, un souvenir doré de Nagasaki en 1950. Ishikawa transporte les téléspectateurs à la décennie après que les États-Unis ont fait exploser une bombe atomique sur la ville portuaire qui, a tué des centaines de milliers de personnes et exposé d’autres personnes à un rayonnement nuisible. Le ton est plus chaud dans cette section, le réalisateur façonnant les images de cette période avec un langage visuel brillant, presque surréaliste.
Ensemble, ces fils forment un film déséquilibré et parfois prosaïque. Non seulement les séquences du Japon d’après-guerre ont plus de résonance que le drame de traumatisme générationnel plus rigide de l’Angleterre des années 1980, mais un vague sens de la méfiance du spectateur afflige cette adaptation. C’est presque comme si Ishikawa, désireux de rendre la justice matérielle de la source, craint que l’invitation de toute ambiguïté échoue au mystère qui propulse le roman d’Ishiguro. Mais un peu d’incertitude peut être bénéfique, surtout quand il s’agit d’interpréter un auteur dont le travail est si obsédant.
Après que Etsuko ait partagé que le stress du déménagement a provoqué des cauchemars, Niki engage sa mère à lui raconter quelques histoires de vie à Nagasaki. La réticence initiale de la femme aînée se dissout dans une volonté timide alors qu’elle se souvient de l’optimisme prudent saturant la ville après la bombe. Au cours de ces années d’après-guerre, Etsuko (maintenant joué par Suzu Hirose, Notre petite sœur) Et son mari Jiro (Kouhei Matsushita), un homme épineux dont les longues heures de travail le rendent à la fois grincheux et distant, attendent leur premier enfant. Leur vie relativement calme subit des changements dramatiques lorsque le père de Jiro Ogata (Tomokazu Miura, Jours parfaits) vient pour un séjour prolongé et Etsuko rencontre Sachiko (Fumi Nikaido de Chagrin), une mère célibataire qui vit dans un chalet délabré à proximité.
La présence des deux figures remet en question Etsuko à affronter l’héritage douloureux de la Seconde Guerre mondiale ainsi que le rôle que les femmes ont joué dans la société d’après-guerre. À Ogata, la femme enceinte commence à comprendre pourquoi une jeune génération se sent trahie par leurs anciens, qu’ils accusent de les conduire à la guerre en raison d’une foi aveugle dans l’impérialisme. Et à travers Sachiko, Etsuko élargit son sens de qui une femme japonaise peut être dans et au-delà de Nagasaki. Sachiko abrite des rêves de quitter la ville avec sa fille Mariko, une enfant solitaire et malcontente qui, selon elle, pourrait prospérer avec une certaine distance du Japon. Quand elle rencontre un soldat américain blanc nommé Frank, qui propose de la prendre à l’étranger, ces rêves semblent plus proches de devenir réalité.
L’un des mystères sous-jacents alimentant le roman d’Ishiguro tourne autour de l’étrange relation entre Etsuko et Sachiko. Les deux femmes, telles que rappelées par Etsuko, peuvent se détacher étrangement et certains critiques ont postulé que l’un pourrait être une projection de l’autre. Une partie du frisson du roman d’Ishiguro est dans la façon dont l’écrivain est ambigu; Le texte offre des indices, mais quelques réponses solides. Cette inscrutabilité intentionnelle rend le livre passionnant, reflétant comment les nations se souviennent ou démêlent des ruptures douloureuses dans leur histoire.
Ishikawa, qui en plus de diriger et d’édition Une vue pâle des collines Écrit également le scénario, est le plus confiant avec la chronologie de Nagasaki, qui est conforme à un drame familial conventionnel. C’est quand Ishikawa doit entrelacer et équilibrer cette chronologie avec celle en Angleterre que le réalisateur lutte un peu plus. L’impact de Une vue pâle des collines est émoussé par une tendance à trop expliquer et à s’aplatir.
Pourtant, il y a quelques faits saillants, y compris la relation entre Etsuko et Sachiko. La chimie entre Hirose et Nikaido rend leurs performances convaincantes à regarder et amplifie les éléments intrigants au sein des amitiés de leurs personnages. Ces forces associées à la popularité d’Ishiguro signifient que, malgré ses lacunes, Une vue pâle des collines pourrait trouver un succès aux États-Unis.