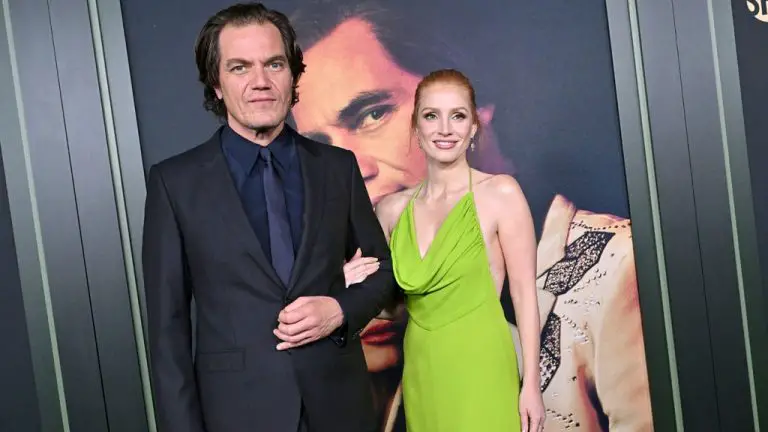La filmographie du réalisateur ukrainien Sergueï Loznitsa peut être divisée en trois genres : les longs métrages (les deux derniers étant Donbass et Une créature doucetous deux de la dernière décennie), des documentaires compilés entièrement à partir de sources d’archives (Le procès de Kiev), et des documentaires sur l’actualité, filmés par Loznitsa lui-même et de petites équipes. L’exemple le plus connu de la dernière catégorie serait Maïdan (2014), un portrait émouvant, astringent, semblable à une mosaïque, des manifestations contre le président soutenu par la Russie, Viktor Ianoukovitch, sur la place principale de Kiev en 2013-2014, qui ont finalement dégénéré en violence.
Avec son dernier, L’invasionLoznitsa donne Maïdan un frère cinématographique, une œuvre qui a un fort air de famille compte tenu de son urgence et de son caractère majestueux et tragique alors qu’elle dresse le portrait d’une nation en guerre. Mais si l’absence de voix off de haute vérité, l’identification des sous-titres ou l’éditorialisation suivent le même modus operandi déployé avec Maïdanil y a ici un sentiment encore plus fort d’engagement direct de la part du cinéaste, d’empathie, de rage et, osons l’appeler, de fierté nationale.
L’invasion
L’essentiel
Sobre mais richement émouvant.
Lieu: Festival de Cannes (séances spéciales)
Directeur: Sergueï Loznitsa
2 heures 25 minutes
Cela ne veut pas dire que le film soit chauvin, et il faut reconnaître qu’il inclut même le son des citoyens ukrainiens se plaignant du président Volodymyr Zelensky et de son régime au début. Ce n’est pas quelque chose qui semble se produire dans les nombreux documentaires sortis d’Ukraine depuis l’invasion russe en février 2022.
Il ne fait aucun doute que la loyauté de Loznitsa va à son compatriote, mais lui et son équipe ne font pas partie de l’histoire comme les journalistes-cinéastes derrière 20 jours à Marioupol, non pas qu’il y ait quelque chose de mal avec cette stratégie à la première personne. Le plus proche L’invasion Ce qui arrive, c’est que les passants regardent directement la caméra, curieux pendant une fraction de seconde peut-être de savoir qui les filme. La plupart des passants devant Loznitsa et les objectifs grand angle des directeurs de la photographie Evgeny Adamenko et Piotr Pawlus sont trop occupés à vivre leur vie pour s’arrêter et parler aux cinéastes.
Avec près de deux ans de séquences sur lesquelles travailler et ce qui a dû être une tâche structurelle formidable dans la suite de montage (des félicitations, peut-être même des médailles, sont dues à Danielius Kokanauskis et Loznitsa lui-même), le matériel semble naturellement se diviser en chapitres. et des sections. Le rythme des changements saisonniers se fait sentir à mesure qu’un hiver succède à un autre, et qu’un été apporte un feuillage luxuriant mais sans interruption de la guerre. Pendant ce temps, un autre rythme s’établit entre les séquences de funérailles (scènes du début du film), les mariages, les nouveaux parents dans une maternité, l’enfance (les élèves d’une école primaire se dirigent vers des abris anti-aérien lors d’un raid aérien, où ils sont assis). dans un autre ensemble de petits bureaux), le service militaire, puis d’autres funérailles, pas toujours nécessairement dans cet ordre.
Des voix, comme celles de ceux qui se plaignent de Zelensky, peuvent souvent se faire entendre. Mais étant donné la préférence de Loznitsa pour les plans longs qui capturent les foules comme un panoramique 18èmeToile du XVIIIe siècle, il n’est pas toujours clair qui parle et s’il est même dans le cadre. Il y a pourtant ici des moments d’intimité déchirante, notamment dans les scènes de la maternité, par exemple celle où un père, vêtu comme tant d’hommes en tenue de combat, rencontre pour la première fois son fils nouveau-né. Et malgré la dureté de la guerre, il est temps de suivre certains volontaires qui circulent près du front pour livrer des colis de soins et des médicaments tactiques, et qui prennent le temps de visiter une école maternelle – l’une déguisée en Père Noël et l’autre en gigantesque rose. chat (également en tenue de combat) — pour offrir des cadeaux aux enfants.
Dans un style slave typiquement bourru, les enfants sont avertis en plaisantant qu’ils n’obtiendront pas de bonbons s’ils ne sourient pas, alors tous obéissent. Mais on ne peut cacher le traumatisme visible sur les visages de chacun ici, des petits enfants chantant des chansons dans le bunker à la femme plus âgée stoïque qui reconstruit sa maison bombardée, brique après brique. Le résultat est une œuvre cinématographique profondément émouvante et poétique qui mérite d’être vue bien au-delà du circuit des festivals.