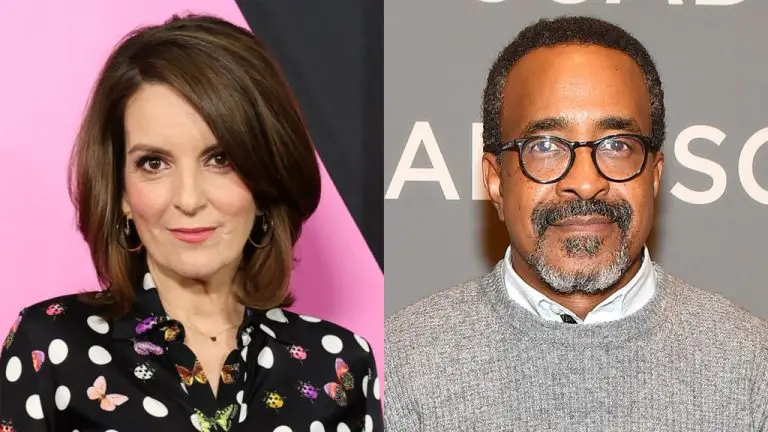La clé, symbole historique utilisé par le peuple palestinien pour représenter sa diaspora de 1948 à aujourd’hui, est le titre donné par Rakan Mayasi à son court métrage présenté au 29ème Festival Medfilm. La célébration du cinéma du Moyen-Orient s’est terminée à Rome le dimanche 19 novembre.
Dans une variante du genre des invasions de domicile, le drame de Mayasi, adapté d’une nouvelle d’Anwar Hamed, voit une famille israélienne tourmentée par un son mystérieux et inquiétant qui se révèle lentement au public comme le bruit d’une clé dans une serrure. C’est comme si quelqu’un à l’extérieur, qui possède la clé de la maison, essayait de revenir. C’est une métaphore politique claire, en particulier pour ceux qui, comme le réalisateur Mayasi, font partie des plus de sept millions de Palestiniens vivant dans la diaspora.
Mayasi a parlé à Le Hollywood Reporter Rome à propos La clé et le rôle du cinéma palestinien à la suite des attaques du Hamas du 7 octobre et de la guerre en cours à Gaza.
Dans La clé, votre point de vue en tant que réalisateur est palestinien, mais les personnages sont israéliens. D’où vient ce choix de perspective ?
Les personnages qui réagissent au son sont israéliens, mais le véritable protagoniste est invisible. Et c’est le bruit derrière la porte, le bruit de la clé dans la serrure : le droit des Palestiniens au retour chez eux. Je me suis senti très inspiré par cet aspect de l’histoire car ses éléments sont un moyen de jouer avec le son et l’image.
Votre court métrage est basé sur la nouvelle du même nom d’Anwar Hamed. Qu’est-ce qui vous a attiré vers ce sujet ?
Je travaillais déjà sur un court métrage de science-fiction lorsque je suis tombé sur cette histoire et j’en ai été fasciné. Beaucoup de choses ont retenu mon attention, y compris le genre du thriller fantastique, le point de vue palestinien sur les personnages israéliens, le fait que le son hors écran soit la dynamique motrice du récit, la subtilité de l’intrigue entière et, par-dessus tout, le message principal. . Le droit des Palestiniens au retour chez eux, sur leur terre, est abordé d’une manière nouvelle et créative. Tous ces éléments m’ont convaincu de contacter immédiatement Anwar Hamed pour adapter son texte. C’est une histoire audacieuse que j’ai voulu transformer en un court métrage audacieux.
La violence dans le court métrage est implicite mais non montrée, tout au plus est-elle entendue dans le bruit des coups de feu. Quelles ont été vos références esthétiques lors de sa construction ?
C’était dans l’histoire originale. Les armes à feu sont très répandues dans la société israélienne, ce n’est donc pas un élément surprenant. La violence dans l’histoire et dans le film se construit progressivement, en fonction du besoin dramatique d’une tension croissante.
Étant donné que La clé appartient à un sous-genre de l’horreur, celui de la violation de domicile, qui est souvent lié à des thématiques politiques, l’esthétique du film a-t-elle été guidée par la nature de son message ?
Pour moi et les sept autres millions de Palestiniens de la diaspora, Israël ne nous permet pas de retourner sur notre terre. Il semble y avoir une profonde peur de notre retour. Je n’appellerais donc pas cela une invasion de domicile mais plutôt un retour des habitants d’origine. L’idée même de mettre une clé dans la serrure, de la tourner et d’essayer d’ouvrir un passage est un acte de retour et non une invasion. Il n’y a pas de violence dans le retour à la maison. Au contraire, c’est une manière d’envahir la conscience des colons. N’oublions pas que la clé est déjà un symbole historique palestinien, le symbole d’un droit que nous revendiquons depuis 1948.
La famille israélienne prend des tranquillisants pour essayer de dormir et pour ignorer le bruit de la clé. C’est une autre métaphore puissante.
L’un des thèmes principaux du film est l’oubli. La société israélienne n’a aucun souvenir des souffrances et des droits des Palestiniens. Ceci est également compris comme l’intrigue de La clé se déroule. Les sédatifs sont ajoutés pour renforcer cette idée, tandis que le bruit de la nuit vient déchirer l’inconscient.
En tant que réalisateur palestinien, pensez-vous que quelque chose a changé depuis le 7 octobre en ce qui concerne la manière dont vous pouvez exprimer votre expérience ?
La priorité est désormais le cessez-le-feu. Moi et tous les Palestiniens que je connais, avons été tellement immergés émotionnellement et mentalement dans ce qui s’est passé depuis le 7 octobre que je n’ai pas eu l’occasion d’y réfléchir. Il est certain que la voix de la Palestine n’a pas pu être entendue dans les grands médias depuis longtemps. Et nous craignons que même dans les espaces indépendants, sur les plateformes artistiques, lors des festivals, cette voix soit réduite au silence, censurée ou privée du droit de s’exprimer en public et dans des contextes institutionnels. J’espère que cela n’arrivera pas. En revanche, il semble y avoir une plus grande prise de conscience. De plus en plus de gens s’intéressent à la cause palestinienne et souhaitent soutenir nos droits.
Selon vous, quel est le rôle du cinéma dans la narration de l’histoire de la Palestine et des Palestiniens d’aujourd’hui ?
Le cinéma est puissant. Il transcende de nombreux arts car il apporte une expérience audiovisuelle plus forte et plus complète. Les films sont faits pour durer et le cinéma a la capacité d’enregistrer notre présent pour le futur. Nous, Palestiniens, ne faisons pas exception en ce sens. Il y a des films palestiniens très importants qui ont donné notre voix au monde parce que le cinéma n’est pas un fait divers à la télévision. C’est beaucoup plus métaphysique et certainement d’un plus grand impact créatif et émotionnel.